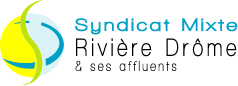La rivière Drôme et ses affluents présentent des caractéristiques de cours d’eau torrentiels. Lors de fortes pluies, ces rivières peuvent entrer en crue de façon soudaine et violente, pouvant mettre en danger les personnes et les biens. Avec le réchauffement climatique, ces événements pourraient devenir plus fréquents et plus intenses. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Drôme trace une feuille de route ambitieuse pour renforcer la résilience du territoire et protéger durablement les habitants, les activités et l’environnement.
Comprendre les risques d’inondation
Les inondations surviennent principalement en hiver et au printemps, sous l'effet de fortes précipitations, souvent accentuées par la fonte des neiges (régime pluvio-nival). Elles peuvent cependant se produire à tout moment de l’année, notamment lors d’épisodes orageux violents.

Quatre grands types de risques d’inondation sur le bassin de la Drôme
- Le ruissellement pluvial. Lors de pluies intenses, le sol n’absorbe pas toute l’eau. Ce phénomène est amplifié par l’imperméabilisation des sols consécutive à la construction de bâtiments et de routes, mais également par la pente naturelle du terrain, qui favorise l’écoulement rapide de l’eau. Certaines communes, comme Luc-en-Diois, Die, Crest ou Livron, sont particulièrement vulnérables à ces inondations.
- Le débordement de cours d’eau. Ce phénomène de crue se produit lorsque le niveau d’une rivière ou d’un cours d’eau dépasse les limites de son lit. Le courant devient plus fort et l’eau s’étend sur les zones alentour pouvant toucher habitations, campings, activités économiques ou équipements publics. Ce risque concerne particulièrement Grâne, Piégros-la-Clastre ou Crest.
- La rupture d’ouvrages (digues, remblais, etc.). Des digues et remblais ont été construits le long de la Drôme et de ses affluents pour contenir les crues. Mais certains de ces ouvrages sont anciens et en mauvais état. En cas de rupture, l’eau peut s’échapper brutalement. Ce risque a été identifié sur les communes de Livron-Loriol, Allex, Grâne ou Pontaix.
- La remontée de nappes phréatiques. Lors d’évènements pluvieux durables, le niveau des nappes libres - les nappes au contact de l’air -, plutôt situées en aval du bassin, peut atteindre la surface et ainsi provoquer des inondations.
Agir en amont pour prévenir les inondations
Mieux connaître pour mieux anticiper
La connaissance fine du territoire et des phénomènes d’inondations permet d’agir efficacement. Le suivi des crues, l’amélioration des cartographies, la mise en place de zonages et la collecte de données sur le ruissellement sont autant d’outils pour orienter les décisions et les aménagements.
Des stations de mesure existent déjà (pluviomètres, capteurs de niveaux, alertes météo), mais elles restent partielles. De nouveaux équipements sont à l’étude pour renforcer cette surveillance.
Intégrer le risque dans l’urbanisme
La révision du SAGE Drôme permet d’identifier précisément des zones à risque et celles qui jouent un rôle naturel en ralentissant l’écoulement de l’eau. Ces données sont ensuite intégrées dans les documents d’urbanisme afin de guider les projets d’aménagement.
Par exemple, une commune qui souhaite créer un nouveau quartier doit s’assurer de la compatibilité de son projet avec les objectifs et les recommandations du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE). Si la zone concernée se trouve en zone inondable ou dans un secteur essentiel à la régulation naturelle des crues, le projet pourra être adapté ou déplacé.

Informer, avertir et protéger les populations
La connaissance sur les risques doit être partagée pour informer et sensibiliser habitants, élus et services de secours. Les plans communaux de sauvegarde (PCS) sont des outils clés pour organiser la gestion de crise à l’échelle locale. Ils permettent de planifier la mise à l’abri des habitants, de coordonner les secours et de limiter les conséquences des inondations.
Aujourd’hui, une vingtaine de communes du bassin versant disposent d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Conçus pour optimiser la gestion des crises, ces plans permettent d’anticiper, d’organiser et de coordonner les actions avant, pendant et après un épisode critique. Pour rester efficaces, ils doivent être régulièrement actualisés et testés à travers des exercices de simulation.
Adapter les ouvrages et infrastructures existants
Des digues à rénover
Entre la fin du 18e siècle et le début du 20e, de nombreuses digues ont été construites pour se protéger des dégâts causés par les crues et gagner des terres exploitables sur le lit de la rivière. Aujourd’hui, certains de ces ouvrages, notamment en basse Drôme entre Crest et Livron/Loriol, sont dégradés et plus adaptés.
Le syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD), en charge de la gestion de ces digues depuis 2018, a mené un diagnostic complet pour évaluer leur état. Les ouvrages les plus sensibles ont été identifiés et feront l’objet d’études spécifiques dans le cadre du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) afin d’évaluer les différentes options possibles (reconstruction, aménagement, recul ou démolition, etc.).

Proposer des aménagements de proximité
Des petits aménagements peuvent protéger des enjeux sensibles ou isolés (quartiers, zones d’activités, infrastructures). Ces solutions permettent de réduire le risque et apportent une réponse adaptée à chaque cas.
Restaurer les milieux naturels pour ralentir les crues
Des solutions fondées sur la nature
- Préservation des zones humides : une zone humide est un milieu naturel où l’eau est présente de manière permanente ou temporaire. Cela peut être sous forme d’étangs, de marais, de tourbières, de prairies inondables ou encore de forêts alluviales. Elles fonctionnent comme des éponges naturelles, en absorbant l’excès d’eau lors des fortes pluies et en la relâchant progressivement, ce qui réduit le risque d’inondation.
- Renaturation des cours d’eau : cette approche consiste à redonner aux rivières un tracé plus naturel. En restaurant les méandres et en laissant plus d’espace aux cours d’eau, l’eau s’écoule plus lentement, s’infiltre mieux dans les sols et limite les crues en aval.
- Infiltration des eaux de pluie : cette technique vise à favoriser l’absorption de l’eau par les sols plutôt que son ruissellement direct vers les rivières. Cela passe par des solutions comme des sols perméables (éviter le béton et l’asphalte), des bassins de rétention, ou des haies et végétaux qui ralentissent et filtrent l’eau.
-
L’hydrologie régénérative : cette approche vise à restaurer et imiter les processus naturels pour mieux gérer l’eau. Elle cherche à ralentir, stocker et infiltrer l’eau au plus près de là où elle tombe, en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des sols et des écosystèmes.

Plusieurs actions opérationnelles ont déjà été menées dans ce sens sur le bassin versant de la Drôme :
- la restauration de la rivière Saleine à Crest (2019)
- la réhabilitation du Lac des Freydières (2023)

A noter également l’identification des Zones humides et ou encore la délimitation d’un espace fonctionnel autour de la rivière Drôme dans l’optique de préserver ces secteurs sensibles.
Ces démarches doivent être poursuivies et développées au cas par cas, aussi bien dans le lit des cours d’eau que dans les zones humides et les espaces de ruissellement.
Gérer l’espace fluvial
En parallèle de ces actions, un plan pluriannuel d’entretien des berges (PPE) est en place pour entretenir la végétation, limiter l’érosion et éviter l'accumulation de débris. Cette gestion permet de préserver les zones naturelles d’expansion des crues tout en offrant à la rivière la possibilité de se déplacer et d’éroder certaines zones de façon naturelle.
L'intégration de ces approches dans la gestion des cours d'eau assure une résilience accrue face aux risques d'inondation, tout en préservant la biodiversité et la qualité de l'eau.
Un territoire plus résilient face aux inondations
Prévenir les inondations repose sur une combinaison d’actions : comprendre et apprendre à vivre avec les inondations, améliorer la surveillance et intégrer le risque dans les projets d’aménagement, restaurer les milieux naturels, intervenir sur les ouvrages de protection.
Pour ce faire, le SAGE Drôme propose une stratégie claire : améliorer la connaissance et la culture du risque, réduire l’aléa (l’intensité des crues), diminuer la vulnérabilité des territoires et protéger les personnes et les biens. La mise en œuvre des actions concrètes se fait dans le cadre du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).
Et pour suivre nos actions et la révision du SAGE Drôme, abonnez-vous à notre newsletter un mois, un enjeu →
Retour